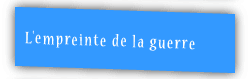|
|||||
Dans l'Enfer de Verdun
Bastien Dez
« Samedi 25 mars 1916 (après Verdun)
Ma chère mère,
[...] Par quel miracle suis-je sorti de cet enfer, je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. [...] Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelles transes et quelles souffrances horribles nous avons passé [...] ».
Seul fils d'une famille de sept enfants, Gaston Biron a 29 ans en 1914 et pendant plus de deux années de guerre, il ne cesse d'écrire à sa mère Joséphine. Six mois avant sa disparition, dans cette correspondance bouleversante, Gaston Biron évoque l'immense tragédie de la bataille de Verdun dont les prémices remontent à quelques semaines.
Paysage de Verdun ravagé
par d'intenses bombardements
Le 21 février 1916, par un petit matin glacial et neigeux, un déluge de feu et de fer provoqué par l'artillerie allemande, le Trommelfeuer, s'abat sur trois divisions françaises cantonnées dans le secteur de Verdun, situé sur la Meuse. Neuf heures durant, un million d'obus ravagent cet espace annihilant toutes défenses françaises. Dans un épais nuage sombre, les troupes allemandes, succédant à ce « feu roulant » sur les lignes françaises, parcourent ce paysage lunaire, découvrant même, au bois d'Haumont, des fantassins français « endormis », choqués par l'intensité du bombardement.
La surprise est totale au Grand Quartier Général de l'Armée française. Le général Joffre ne s'attendait pas à une offensive allemande dans la région fortifiée de Verdun. La citadelle souterraine, achevée sous le règne de Louis XIII, avait été modernisée à la fin du XIXe siècle et semblait protégée par une vingtaine de places fortes, érigées et fortifiées après la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Or, à l'été 1915, Joseph Joffre avait prit la décision de désarmer ces forts après avoir constaté l'inefficacité des ouvrages fortifiés de Belgique face au feu de l'artillerie lourde allemande. Le 16 décembre 1915, le général Joseph Gallieni, après avoir pris connaissance d'une note du lieutenant-colonel Driant commandant à Verdun, écrivait au généralissime Joffre : « De différentes sources parviennent des comptes-rendus sur l'organisation du front et signalant en certains points des défectuosités dans le système de défense. En particulier et notamment dans les régions de la Meurthe, de Toul, et de Verdun, le réseau de tranchées ne serait pas complété comme il l'est sur la majeure partie du front. [...] Cette situation, si elle est exacte, risque de présenter les inconvénients les plus graves ». Au commencement de l'année 1916, la convergence des trains de l'Armée allemande à proximité de Verdun et les informations collectées auprès de déserteurs alsaciens par le service de renseignements des armées françaises n'avaient pourtant pas alerté l'Etat-major d'une possible offensive.
La Voie sacrée
Le 12 février 1916, l'ordre du jour du Kronprinz témoigne de l'imminence d'une attaque allemande dans le secteur de Verdun. « Après une longue période de défensive acharnée, l'ordre de Sa Majesté l'Empereur et le roi nous appelle à l'attaque [...]. » écrit l'héritier de Guillaume II. Les combats du 21 février 1916 révèlent l'avantage écrasant de l'artillerie allemande et mènent les Allemands à une dizaine de kilomètres de Verdun. Le 25 février 1916, le fort de Douaumont, désarmé, tombe sans la moindre résistance. Le commandement du secteur est confié au général Philippe Pétain qui organise le ravitaillement des forces armées en vivres et en munitions et obtient l'arrivée de 190 000 hommes remplaçant blessés et permissionnaires par l'unique liaison entre la cité de Verdun et l'arrière, la fameuse Voie sacrée.
En mars, les combats font rage autour des positions françaises de la crête du Mort-Homme et de la Côte 304. Le 9 avril 1916, les troupes allemandes attaquent violemment les rives de la Meuse et occupent, le lendemain, les bois des Corbeaux, de Cumières et les pentes nord du Mort-Homme. Les Français résistent au sommet de ce coteau en dépit de lourdes pertes. « Courage ! ... On les aura ! ... » écrit Philippe Pétain dans son ordre général du 10 avril afin de féliciter et encourager les soldats. Le général Pétain nommé au commandement du Groupe d'armées du Centre, Robert Nivelle prend la direction des opérations du secteur de Verdun le 1er mai 1916. Un mois plus tard, les forces allemandes prennent d'assaut le fort de Thiaumont et assaillent d'obus le fort de Vaux. Après sept jours de combats acharnés et de résistance héroïque, les soldats français du commandant Raynal se rendent. L'avancée allemande est alors arrêtée par quatre contre-attaques lancées par Charles Mangin du 24 au 27 juin 1916, au prix de terribles pertes, notamment parmi les combattants des colonies. Attaqués sur la Somme depuis le 1er juillet par les armées franco-britanniques, les Allemands lancent une ultime offensive sur Verdun le 11 juillet. Sans succès. Verdun n'est toujours pas aux mains des armées du Kaiser. Le 13 septembre 1916, Joffre demande aux généraux Philippe Pétain et Robert Nivelle de reconquérir les positions perdues. Les forts de Douaumont et de Vaux sont repris par les troupes françaises et coloniales, respectivement les 24 octobre et 2 novembre 1916. Le 15 décembre, les combats se poursuivent à Hardaumont, Louvemont et à la côte du Poivre. L'enceinte fortifiée de Verdun est rétablie. La bataille de Verdun s'achève, même si tout au long du conflit, les heurts entre combattants français et allemands ne cessent guère.
Le Fort de Douaumont
Juillet 2005
La France sort victorieuse de ce combat immense aux proportions démesurées, au prix d'une terrible hécatombe. Sur ces terres de Lorraine, bouleversées par dix longs mois de violents affrontements, près de 420 000 soldats ont perdu la vie. Les Hommes de Verdun, Allemands et Français, se sont battus pour quelques mètres de territoire, luttant contre la faim, le froid, la neige, la boue et la vermine. Ebranlés par l'horreur déployée, ils ont connu l'indicible et subi l'inimaginable.
Désormais, les massifs forestiers des coteaux de la Meuse ont succédés aux terribles empreintes de la bataille de Verdun, dissimulant les quelques vestiges d'ouvrages fortifiés et de certains villages encore présents de nos jours. Afin que nul n'oublie le sacrifice de ces combattants, les survivants de la Grande Guerre ont érigé un Ossuaire et un Mémorial qui témoignent ainsi de cette communauté d'âmes et de souvenirs d'une des plus grandes batailles de l'Histoire.