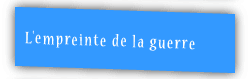|
|||||
Aux origines de la « Force noire »
Bastien Dez
« L’Afrique nous a coûté des monceaux d’or, des milliers de soldats et des flots de sang ; l’or nous ne songeons pas à le lui réclamer. Mais les hommes et le sang, elle doit nous le rendre avec usure » écrit Adolphe Messimy dans le quotidien Le Matin, le 3 septembre 1910. Ce député de la Seine apporte ainsi son soutien au projet du Lieutenant-colonel Charles Mangin de faire de l’Afrique le réservoir d’une grande « Armée noire » pour l’avenir, développé dans son ouvrage La Force noire (1).
Ces liens complexes entre la France et le continent africain se nouent dès la fin du XVIe siècle. Dès l’origine de la présence française en Afrique occidentale, des miliciens africains reçoivent pour mission de protéger les établissements commerciaux de la métropole sur les côtes sénégalaises. Le 21 juillet 1857, Louis Faidherbe, gouverneur du Sénégal, obtient de l’empereur Napoléon III, par le décret de Plombières-les-Bains, la création du premier bataillon de tirailleurs « sénégalais ». A la fin du XIXe siècle, la France, irrésistiblement engagée dans la « course aux colonies », engage massivement « ses » soldats africains. Ces tirailleurs participent ainsi aux campagnes de l’expansion coloniale. En 1900, le 1er Régiment de tirailleurs « sénégalais » est formé au Sénégal, à Saint Louis. Toutefois, en dépit de cette appellation, nombre des combattants de ces unités d’infanterie africaine appartiennent à plusieurs ethnies de l’Afrique occidentale française.
Le Colonel Mangin s'entretient avec
des tirailleurs "sénégalais" au Maroc, 1912.
En 1910, de nombreuses études sont réalisées au cœur des territoires de l’Afrique occidentale française, dirigées par le Lieutenant-colonel Mangin. Ces terres françaises de l’Ouest africain comprennent cinq colonies civiles – le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Dahomey et le Haut-Sénégal et Niger – et deux territoires militaires – la Mauritanie et le Niger. Cette mission au sein des cercles africains de l’Afrique occidentale française, ponctuée par de nombreux palabres exaltant le métier des armes, souhaite constituer une force armée importante composée de combattants africains. Chaque année, 1 à 5% de la population masculine locale doit ainsi être sollicitée, soit 40.000 hommes pour l’ensemble des territoires considérés. Toutefois, de multiples disparités et ambiguïtés ponctuent ce projet formulé dans l’ouvrage de Charles Mangin, La Force noire. Certaines populations et certains espaces de l’Ouest africain sont écartés de ces desseins.
Reconnaissant que l’homme africain « naît soldat plus encore que guerrier », qu’il possède « les qualités que réclament les longues luttes de la guerre moderne : la rusticité, l’endurance, la ténacité, l’instinct du combat, l’absence de nervosité, et une incomparable puissance du choc », le Lieutenant-colonel Mangin distingue cependant deux groupes de combattants. Le premier d’entre eux, celui des « races guerrières », est composé d’agriculteurs sédentaires, dont font partis les Mandingues (Bambaras et Malinkés), les Sérèrs, les Wolofs et les Toucouleurs notamment (2). Le second, celui des « races fragiles », réunit les populations des savanes, des zones forestières ou côtières et celles réfractaires au métier militaire « à l’européenne », dont font partis les Gouros, les Baoulés, les Sénoufos et les Peuls notamment.
Cet « inépuisable réservoir d’hommes » que constitue l’Afrique occidentale française ne suscite guère d’enthousiasme, ni en métropole, ni sur les terres africaines. En dépit du décret du 7 février 1912 instituant un service militaire de quatre années dans les colonies (3), s’ajoutant à l’engagement volontaire de 5 à 6 ans, seulement 16.000 jeunes africains sont appelés sous les drapeaux entre 1912 et 1913 afin de participer aux opérations de « pacification » au Maroc. A la veille de la Première Guerre mondiale, la puissante « Armée noire » tant espérée par Charles Mangin et ses disciples n’est qu’une illusion.
Ainsi, les écrits de Charles Mangin louant la contribution des combattants d’Afrique subsaharienne aux opérations militaires françaises sur le continent européen au début des années 1910 témoignent véritablement des origines de l’engagement des tirailleurs « sénégalais » au cœur des combats de la Grande Guerre en Europe dès l’année 1914.