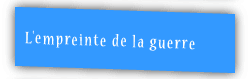|
|||||
Survivre à la guerre : le rôle des images
Marine Duponchel
Les images sont à la fois des supports du discours et des illustrations de l’actualité. Elles permettent la diffusion rapide de l’information. On a beaucoup parlé de leur production « pour » et « par » l’arrière mais il faut bien noter que cette guerre est également, et en grande partie, la réalité quotidienne des combattants qui, prisonniers de leurs tranchées, se font leur propre idée de cette actualité. Nous allons voir que les images jouent aussi un rôle primordial pour résister et survivre à la guerre.
Les poilus ou la réalité des héros
Témoignages de guerre, une esquisse
d'un combattant français
Les soldats sont d’importants producteurs d’images car beaucoup d’entre eux dessinent ou font des photographies. Peu sensibles aux informations diffusées par les professionnels à la recherche de l’action et du sensationnel, les combattants qu’ils soient sur le front, blessés ou prisonniers, fabriquent une autre image de leur guerre. L’action s’efface au profit de l’attente et des diverses corvées exigées par la hiérarchie pour garder la discipline et l’esprit combatif. Les photographies ou les dessins des soldats choisissent de montrer des paysages, l’environnement quotidien, les camarades ou le matériel.
Ces images privées voire intimes ne montrent pas, ou rarement, des événements factuels mais elles constituent des sources précieuses pour les historiens qui peuvent alors approcher l’état d’esprit de ces hommes et leurs conditions de vie. Les quelques 930 films militaires tournés par l’armée, entre 1915 et 1919, évoquent également ce quotidien. Ce sont généralement des petits courts métrages qui retracent les activités des soldats : le thème du ravitaillement comme celui de la soupe est mainte fois repris.
Ces médias photographiques et cinématographiques montrent aussi les difficultés et les aspects souvent dégradants de cette survie humaine. L’arrière prend alors conscience de l’inconfort permanent et des souffrances que ces hommes subissent au quotidien. Ils sont sales, ils ont froid ou trop chaud, ils vivent dans la boue, dans l’humidité et surtout dans la peur. L’image aseptisée du combattant héroïque disparaît. Les poilus sont présentés comme des combattants modernes dont l’héroïsme tient désormais à la ténacité physique et la résistance morale.
Entre l’arrière et le front : les échanges pour tenir
Pour tenir plus de trois ans, les échanges postaux et la circulation des images entre le front et l’arrière ont joué un rôle décisif. Le film de Charlie Chaplin, Shoulder Arms (ou Charlot soldat pour la version française), qui est sorti aux Etats Unis en 1918, est un bon exemple des conditions de vie du soldat pendant la guerre. Ce petit film muet, en noir et blanc, est intéressant à plus d’un titre. D’abord parce qu’il s’agit d’une production américaine (un des Alliés) qui met en scène un soldat dans les tranchées françaises. Mais aussi car, fidèle à lui-même, Charlie Chaplin utilise les procédés comiques pour faire passer ses messages. Par exemple, Charlot a des difficultés à marcher au pas tandis que les chefs allemands sont ridiculisés. Ce qui nous intéresse, c’est surtout sa représentation du front. L’idée émouvante de l’éloignement et de la nostalgie du soldat sont justement retranscrites. Il insiste beaucoup sur l’attente des nouvelles et cette nécessité à recevoir des lettres. On correspond pour rassurer et préserver ses proches. Ce film, on ne peut plus patriotique, défend les valeurs optimistes des Alliés et n’est diffusé en France qu’en mai 1919.
Des nouvelles familiales
François Pairault explique par ailleurs que la Première Guerre mondiale marque l’âge d’or de la carte postale. Malgré l’orientation des discours qui diffusent la figure de l’ennemi ou les thèmes patriotiques, la carte postale est un bon indicateur des mentalités au sein de la population. De véritables réseaux de solidarité sont organisés pour soutenir les poilus blessés ou prisonniers du front. On envoie des colis qui contiennent des denrées alimentaires comme des conserves ou du chocolat mais aussi des lettres et des photographies. Ces images peuvent être intimes : la photographie d’un parent, souvent de l’épouse ou des enfants mais aussi des photographies de l’arrière en général. Posés, ces clichés consistent à montrer au front que la France les soutient en travaillant et en gardant un bon moral. On voit par exemple des agriculteurs au champ, des grandes tablées de paysans qui regardent l’objectif en souriant.
Ainsi, la France entière cherche à montrer qu’elle résiste et qu’elle tient bon face à l’envahisseur. Et si les civils s’inquiètent pour les soldats, le front aussi craint la fragilité de l’arrière. Une caricature de Forain dans L’opinion du 9 janvier 1915 met en scène deux poilus dans leur tranchée « Pourvu qu’ils tiennent ! Qui ça ? Les civils ». L’image matérialise donc l’absence et contribue à l’abolition des frontières entre la guerre et le monde. Le choix des illustrations et des slogans rappelle que les Français ont mis leur vie entre parenthèse. Les représentations de l’arrière sur les affiches diffusées pour inciter les citoyens à aider financièrement l’Etat montrent bien que les Français sont suspendus dans une sorte de consensus, en quête permanente du futur. On représente la victoire proche ou le moment des retrouvailles en s’appuyant sur les schémas d’une réalité d’autrefois, passée et très regrettée.
Traces et empreintes de la guerre : les images mentales
Enfin, ce premier conflit mondial a laissé beaucoup de traces dans l’imaginaire individuel et collectif des Français. Il a bien sûr laissé des empreintes dans le paysage au travers des dégâts matériels et de la déformation de la géographie, essentiellement là où s’est cristallisé le conflit pendant plus de trois ans. La guerre marque également l’espace par l’élaboration des différents monuments aux morts érigés à la mémoire de tous ces combattants. On cultive alors ces images et on les entretient pour se souvenir et rendre hommage aux sacrifiés de la Patrie.
Otto Dix, Die Skatspieler
(Les joueurs de cartes),
huile sur toile et collage,
110 x 87 cm.
Les discours patriotiques défendus par les films muets durant la guerre sont de leur côté remis en cause dès le début du cinéma parlant qui prône le pacifisme : on ne conserve donc pas toutes les images que l’on a élaborées, on en refoule certaines, on en dénonce d’autres.
Et puis la guerre a marqué tous les esprits, à sa manière. Les images intimes et personnelles produites par les artistes peintres sont intéressantes. Entre déformation de la réalité et exacerbation de la douleur, certains comme Otto Dix dénoncent la cruauté de ce conflit. Ils rendent comptent de la souffrance et de la violence à vivre avec ces gueules cassées, qui sont alors les traces indélébiles de la haine et surtout de la bêtise. L’image artistique est une expression. Elle raconte la guerre à la manière de celui qui l’a vécu, qui l’a vu, qui l’imagine. Félix Valloton peint, en 1917, le cratère de Souain. Cette toile quasiment abstraite montre un paysage dévasté, complètement lunaire en pleine nuit… On peut de nouveau parler de la guerre sans la montrer car cette fois-ci, l’image suffit pour l’évoquer. L’image n’est plus seulement une illustration, elle n’a plus besoin de montrer puisqu’elle raconte. Elle est devenue autonome.